| ACCUEIL | ARCHIVES | ABONNEMENT | COURRIER | RECHERCHE |
|
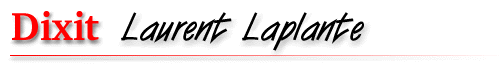 |
|
| ACCUEIL | ARCHIVES | ABONNEMENT | COURRIER | RECHERCHE |
|
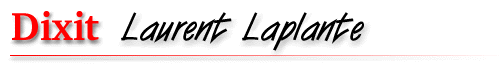 |
|
| Québec, le 10 février 2003 Rockefeller plutôt que Powell L'anecdote est si magnifique dans sa bêtise qu'elle devient immensément révélatrice. En prévision du réquisitoire qu’allait prononcer le secrétaire d’État américain en faveur de la guerre contre l’Irak, on aurait veillé à voiler Guernica, la tapisserie reproduisant la dramatique fresque de Picasso que la veuve du milliardaire américain Nelson Rockefeller a offerte à l'ONU en 1985 et qui se trouve à l'entrée de la salle du Conseil de sécurité à New York. Il ne fallait surtout pas que les caméras puissent présenter des scènes de carnage, même stylisées, au moment où Colin Powell martelait son appel à la guerre. Rockefeller avait au moins compris ceci : l'ONU existe pour empêcher la guerre; Colin Powell tient tellement à sa guerre qu'il détourne l'ONU de sa mission. Dans son raccourci, l'anecdote sidère. Puis, il faut bien surmonter le choc et se demander : « Maintenant, que se passe-t-il? » Comme certains êtres surdoués et superficiels que nous avons tous connus, Colin Powell a utilisé la tribune du Conseil de sécurité pour tout dire sauf l'essentiel. Il a reproché aux Irakiens de déplacer sans cesse tel ou tel matériel incriminant, ce qui ne devrait pas déconcerter les Américains s'ils se souviennent des astuces nord-vietnamiennes. Powell s'est scandalisé de ce que l'Irak fasse de son mieux pour éviter les inspections qui les mettraient dans l'embarras, mais, en accusant Saddam Hussein de jouer au chat et à la souris, il a négligé de justifier l'espionnage pratiqué par les Américains au coeur d'un pays souverain. Powell a affirmé que des produits dangereux étaient stockés quelque part en Irak, mais il n'a pas osé présenter la preuve qui aurait peut-être emporté l'adhésion : le nom des fabricants américains qui ont équipé l'Irak et la nature exacte des armes répandues par les très moraux donneurs de leçons. Ce fut pire encore à propos du terrorisme international. Le secrétaire d'État américain a eu beau convertir ses cauchemars en « preuves », il n'a jamais établi de lien crédible entre Saddam Hussein et ben Laden. Il n'a pas expliqué non plus pourquoi, dès son tout premier voyage à titre de secrétaire d'État, il s'en était pris à l'Irak. Bien lui en prit, car il aurait démontré ainsi que l'obsession de l'administration Bush au sujet de l'Irak était fébrile et motrice bien avant les attentats de septembre 2001. L'essentiel, Colin Powell l'a soigneusement escamoté et dans toutes ses modalités. Tout en accusant l'Irak de ne pas collaborer avec les inspecteurs de l'ONU, il a prouvé que les États-Unis ont systématiquement privé les mêmes inspecteurs d'informations qui leur auraient été utiles. Sur les ondes de Radio-Canada, un invité américain de Michel Désautels explique ces cachotteries en prétendant que les inspecteurs auraient transmis aux Irakiens toutes les informations qu'on leur confiait. Tout en vilipendant l'Irak pour ses réticences à l'égard de la résolution 1441, M. Powell s'est comporté en censeur de l'ONU : « C'est un test pour vous, a-t-il dit en substance. Si vous n'assumez pas ce que les États-Unis jugent être vos responsabilités, nous le ferons à votre place. » Façon arrogante et ostentatoire de traiter l'ONU plus mal que ne le fait Saddam Hussein. M. Powell n'a pas non plus prouvé, ce qui relève pourtant de l'essentiel, que l'Irak constitue une menace plus grande qu'une bonne dizaine d'autres pays. Au total, on ne peut féliciter M. Powell que si l'on oublie l'essentiel. À dire vrai, l'essentiel de l'essentiel n'a même pas affleuré : quel serait le coût de cette guerre en vies humaines? Il y a, au plus vif de cette crise, un persistant malentendu. Je dis persistant, car il ne date pas de l'arrivée de George W. Bush à la Maison blanche. Ce malentendu, c'est la confusion qu'entretient Washington entre les intérêts américains et les droits américains. Si un intérêt américain est mis en cause, aussitôt l'armée intervient pour le protéger ou le récupérer. Jamais, dans ce processus, on ne s'interroge sur la légitimité de l'action militaire. Il suffit d'un appétit insatisfait pour que la conquête soit traitée comme un droit. Le vocabulaire américain trahit d'ailleurs cette vision des choses. En effet, les États-Unis consentent à discuter quelque temps avec l'ONU, mais ils se réservent le « droit » d'agir seul si l'ONU refuse de cautionner leur impérialisme. Ce droit n'existe que dans le somptueux imaginaire américain. Il rappelle en termes de pensée magique le comportement du bambin que la vie en maternelle n'a pas encore socialisé : tous les jouets lui appartiennent de droit puisqu'il en a le goût. La vérité, c'est que l'intérêt américain pour le pétrole irakien ne confère pas aux États-Unis le droit d'attaquer ce pays. La vérité, c'est aussi que les États-Unis ont, comme tout autre pays, le droit de présenter leur plaidoyer devant les Nations Unies, pas celui d'asseoir la communauté internationale sur le banc des accusés ni celui de cumuler les rôles d'accusateur et de juge de cette communauté. La vérité, c'est que la démocratie que défendent avec tant de verbosité les membres de l'administration Bush n'a de sens et de valeur que si elle permet le débat entre égaux. Si, dès l'instant où la France ou l'Allemagne prétend définir sa propre pensée, les États-Unis cessent de voir en elles des alliées, on se demande bien à quelle démocratie étriquée nous devons maintenant nous résigner. Retournons par la pensée à un autre moment charnière de l'histoire. Le 6 août 1945, c'était Hiroshima. Le 8 août Albert Camus écrivait ceci :
Puis, il enchaînait :
L'essentiel, c'est ce dont parlait Georges Bernanos dans son journal de 1939-1940 : « Qu'une guerre soit réellement une juste guerre, nul, je pense, ne saurait l'affirmer avant la paix. Ce sont les paix justes qui font les guerres justes. » Voilà un essentiel qu'ignorent ceux qui ne veulent pas la paix. Étrange procès que celui auquel Colin Powell nous a conviés : un État est condamné à mort pour meurtre par quelqu'un qui n'est pas son juge et sans qu'il y ait de cadavre pour fonder la preuve. |
| Laurent Laplante | |
RÉFÉRENCES :
| |
Imprimer ce texte ACCUEIL | ARCHIVES | ABONNEMENT | COURRIER | RECHERCHE |
© Laurent Laplante et les Éditions Cybérie |