| ACCUEIL | ARCHIVES | ABONNEMENT | COURRIER | RECHERCHE |
|
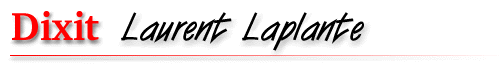 |
|
| ACCUEIL | ARCHIVES | ABONNEMENT | COURRIER | RECHERCHE |
|
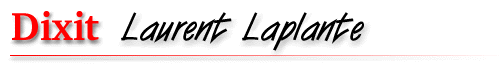 |
|
| Québec, le 23 septembre 2002 Un fossé inquiétant Coup sur coup, deux sondages laissent craindre qu'une notable différence existe au Québec entre les perceptions des citoyens et les descriptions que présentent les médias. S'il ne s'agissait que de préoccupations marginales ou de domaines requérant une patiente appropriation des données, on comprendrait et, bon gré mal gré, on se résignerait à un tel hiatus. Quand, au contraire, c'est à propos de l'école et des services de santé que les citoyens et les médias entretiennent des impressions différentes et même contraires, un examen de conscience s'impose chez les professionnels de l'information. Cet examen est d'autant plus nécessaire à ce moment-ci que le gouvernement québécois a adopté récemment et respecte depuis peu une politique de grande fermeté à l'égard de certaines catégories de médecins. Si le verdict des médias à propos de ce virage délicat devait tomber sans précautions suffisantes et déformer une fois encore la réalité, le risque est grand de voir la médecine québécoise esquiver encore une fois ses responsabilités. Commençons par l'éducation. En un mot comme en cent, le public québécois est, de tous les auditoires provinciaux interrogés au sujet de l'école, l'un de ceux qui professent l'opinion la plus favorable. Environ deux tiers des répondants se déclarent satisfaits. Une certaine presse n'en finit plus, cependant, de mettre en exergue les inévitables ratés du système, depuis l'extorsion, rebaptisée « taxage » au plus grand mépris et dans la plus vaste ignorance de l'usage souhaitable de ce terme, jusqu'au décrochage en passant, va sans dire, par les accusations d'agressions sexuelles trop volontiers lancées contre les professeurs et trop souvent oubliées quand arrive un verdict d'innocence. Une sorte de préalable inavoué et peut-être inconscient pousse de nombreux journalistes à voir dans les bavures du système non pas l'exception, mais la preuve d'une inadéquation globale et presque génétique. Le public, du moins quand on sollicite les opinions individuelles, voit les choses autrement et décerne de fort bonnes notes à son école. Le public reçoit comme message médiatique que les choses vont mal et il ne se sent pas en mesure de contredire cette affirmation; l'individu peut, tout au plus, dire que, pour sa part, il n'a pas à se plaindre. On sait pourtant, du moins depuis des vérifications assez récentes, que les jugements sévères sur l'école proviennent surtout de gens qui n'en vivent pas le quotidien. Autrement dit, ceux qui, par vieillissement ou par absence de progéniture, n'ont pas à conduire un enfant à l'école, ni à suivre ses progrès scolaires, ni à rencontrer les copains et les enseignants, ceux-là, de loin et de haut, multiplient les reproches. À l'opposé, on obtient des commentaires nettement plus conciliants de la part de ceux qui ont l'occasion de fréquenter l'école, de traiter avec des services comme le transport scolaire, l'organisation des repas ou la remise des bulletins. Sur quoi se basent ceux et celles qui blâment l'école sans la connaître? Voilà la question. Dans un autre domaine névralgique, la santé, un fossé comparable s'observe entre la satisfaction du public et les bilans présentés par les médias. On aura beau tordre en tous sens les résultats du sondage mené par le ministère de la Santé et des Services sociaux, on ne parviendra pas, en tout cas, à les interpréter comme une preuve d'insatisfaction. Bien au contraire. Une différence est même tangible entre les chiffres concernant l'école et ceux qui s'appliquent à l'hôpital. La satisfaction, en effet, est plus grande dans le domaine, la santé, où plus de personnes répondent en connaissance de cause! Rares, en effet, sont ceux et celles qui, dans leur chair ou par proche interposé, n'ont pas récemment expérimenté la réalité hospitalière. L'analyse se répète : quand on entre en contact avec la réalité de l'hôpital, on la juge avec une plus grande sérénité. Ce qui réitère la question : sur quoi se basent ceux qui décrivent la situation comme lamentable et honteuse? On ajouterait un troisième domaine que l'on observerait un fossé comparable. La population croit, en effet, que le crime est, depuis des années, en progression effarante et incontrôlée, alors que les chiffres, que les corps policiers gonflent pourtant de leur mieux, démontrent un plafonnement et même un recul de la criminalité. Le question revient : sur quoi se basent les gens qui, dans l'ignorance des statistiques et sans contact personnel avec l'univers policier et judiciaire, concluent de façon affolante et erronée? Comment expliquer que le public se trompe à ce point dans l'évaluation de la criminalité quand les médias, à commencer par Radio-Canada, consacrent autant de temps à raconter les crimes et les comparutions et à fulminer contre la « légèreté » des sentences et la douceur de l'incarcération? On aura compris que les médias, entre lesquels il faudrait évidemment établir des nuances, ne parviennent pas toujours à décrire le réel tel qu'il est. Ils ont le droit et même le devoir de surveiller l'école, l'hôpital et les tribunaux, mais ils portent une énorme responsabilité quand leur intérêt pour la petite bête noire et pour « the man behind the news » les conduit à mal juger les systèmes et à ne plus voir derrière l'écorce l'arbre et a fortiori la forêt. Ils empêchent la société de se percevoir correctement. Le durcissement du comportement gouvernemental face à divers groupes de médecins fournit l'occasion de réfléchir aux conséquences du conditionnement de l'opinion pratiqué par les médias. Brandir les manchettes fracassantes et crier à la conscription sauvage quand on commence à peine à exiger vraiment la présence des médecins dans les salles d'urgence, est-ce une réaction mesurée? Est-ce une lecture correcte de la situation? Je ne le crois pas. Avant de voler à la défense du pauvre médecin légalement contraint de se présenter dans une salle d'urgence, il importe de se rappeler à soi-même la nécessité absolue et non négociable d'assurer la présence de médecins dans les salles d'urgence. Tel doit être le constat : un besoin vital existe qui n'est pas comblé. Une fois le besoin comblé, il sera temps de raffiner les méthodes, pas avant. Il n'y a tout de même pas de commune mesure entre l'obligation faite à un individu de fournir le service essentiel qu'il a promis d'assurer et la fermeture de services d'urgence pour cause d'absence médicale. Je veux bien qu'on trouve une formule moins brutale que le recours au huissier pour obtenir la présence médicale indispensable, mais qui niera qu'il soit plus que temps de crever l'abcès? Je souhaite, comme tous les médecins et comme tout le monde, que, dans toute la mesure du possible, chacune et chacun conserve le droit de travailler où et quand la chose lui convient, mais ce voeu ne doit pas escamoter l'essentiel. Le goouvernement se donne peut-être tort quant à la forme, le médecin absent a tort quant au fond et quant à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a ici obligation de résultat et donc obligation de présence. Un service d'urgence ayant besoin, absolument besoin de médecins, une société soucieuse du bien commun a le droit et le devoir d'exiger que les médecins soient là. Or, ils n'y sont pas toujours, malgré que le Québec ait tout essayé depuis des lunes et que les médecins aient promis mer et monde. Alors? Les médias ne peuvent jouer indéfiniment sur les deux tableaux. S'ils avaient raison de jeter les hauts cris à la vue de salles d'urgence désertées, ils ont tort, en logique ramenée à l'essentiel, s'ils condamnent la volonté gouvernementale d'y assigner les médecins. La liberté individuelle est certes une valeur à respecter, mais elle s'est octroyée dans le passé le droit d'aller à l'encontre du bien commun. Si les médias se rangent massivement du côté des professionnels qui ont attendu la coercition pour faire fonctionner les urgences, ils devront se regarder dans le miroir si, pendant des années encore, le public souffre d'un engorgement des mêmes urgences. Corrigeons d'abord le mal; voyons ensuite, mais ensuite seulement, à rendre le remède moins difficile à avaler. |
RÉFÉRENCES :
| |
Imprimer ce texte ACCUEIL | ARCHIVES | ABONNEMENT | COURRIER | RECHERCHE |
© Laurent Laplante et les Éditions Cybérie |