| ACCUEIL | ARCHIVES | ABONNEMENT | COURRIER | RECHERCHE |
|
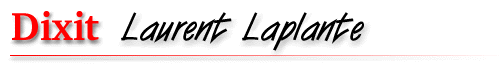 |
|
| ACCUEIL | ARCHIVES | ABONNEMENT | COURRIER | RECHERCHE |
|
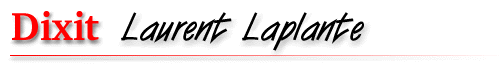 |
|
| Québec, le 22 juillet 2002 Cet État si méprisé Si les conséquences n'étaient pas si graves, on rigolerait en voyant les chantres du libéralisme tout azimut recourir aux pouvoirs publics pour remettre sur ses rails le financement boursier de l'entreprise privée. Celui qui a conquis la présidence américaine en promettant de rendre l'État aussi effacé et servile que possible n'en finit plus de promettre au nom du même État des sanctions plus musclées et des vérifications plus minutieuses. Comme si, face à la dégringolade, Bush préférait, malgré tout, faire confiance à l'État plutôt qu'à ses collègues en maquillage comptable. Au Canada, la réaction gouvernementale contraste aussi nettement avec l'idéologie officielle : ceux qu'on ne cesse d'encenser pour leur contribution à l'essor industriel et économique se font dire qu'on les a à l'oeil. Peut-on lire cette volte-face comme l'indice d'une réhabilitation des pouvoirs publics? Quand même pas. L'interprétation donnée au récent discours d'Allan Greenspan, le maître de la Federal Reserve, est un bel exemple de la surdité d'un certain milieu. Alors que M. Greenspan donnait un cours d'éthique à la classe financière, industrielle et politique, les décideurs gardaient l'oeil sur les indicateurs économiques et cherchaient des motifs d'optimisme dans les prévisions chiffrées de la Fed. Au lendemain de l'intervention, les médias roulaient dans la même ornière et affirmaient que les marchés boursiers n'avaient pas suivi M. Greenspan dans son « optimisme ». Le problème, c'est que M. Greenspan n'a pas chaussé de lunettes roses pour examiner l'avenir et n'a pas versé dans l'optimisme béat. Il a plutôt dit ceci, qui n'est pas du tout la même chose : « L'économie est en assez bon état et la croissance sera probablement plus forte que prévu, mais les patrons d'entreprises se conduisent mal et nous aurons encore des scandales financiers. » Interpréter ce discours comme une incitation à l'optimisme, c'est ne rien comprendre au message. M. Greenspan parle qualité, mais on entend quantité. Il déplore la cupidité des patrons, mais on choisit dans ses propos ce qui concerne une croissance de plus de trois pour cent. On leur jouerait du Mozart que ces gens compteraient les notes. Le commun des mortels, lui, ne s'y est pas trompé. Les Américains ont lu correctement les messages de leur président et de M. Greenspan. Ils ont compris, contrairement à nos revues de presse radio-canadiennes qui éditorialisent en voyant des paradoxes là où règne la cohérence, que le monde des affaires ne pense qu'à lui, mais que la force déployée par l'armée américaine leur vaut une certaine sécurité. Les sondages ne disent pas autre chose : d'après le public, le président ne changera pas les moeurs du monde des affaires, car il ne voit pas ce qu'elles ont de répréhensible, mais il s'attaquera sans état d'âme à tous ceux qui porteraient ombrage à l'hégémonie américaine. Les deux tiers des gens jugent Bush irrévocablement lié aux comportements nauséabonds d'une certaine élite financière; les deux tiers des gens croient Bush prêt à relever tous les défis militaires. En jugeant que l'amoralité politico-financière empêche une économie saine d'offrir sécurité et transparence à l'ensemble des investisseurs, M. Greenspan répartit correctement les responsabilités et dit poliment la même chose. Ni optimisme ni paradoxe par conséquent. On ne doit cependant pas conclure que le libéralisme soit enfin soumis aux exigences du bien commun. L'État, aux yeux de Bush et des grands prédateurs industriels et financiers, est un instrument dont il est parfois rentable de se servir, non l'arbitre entre les composantes de la société. S'il faut faire semblant de le mobiliser pour calmer une opinion devenue méfiante à l'égard de la Bourse, on le fait, mais en veillant à le dégriffer avant de le mettre en chasse. Ceux qui, déguisés en représentants de l'intérêt public, surveilleront le poulailler ont tous fait leurs preuves comme renards. Le pouvoir militaire et policier, mal nécessaire et fauve jamais dompté, ne sera pas racheté par les services qu'il peut rendre à la société, mais ravalé au rôle de mercenaire armé et intimidant. Lui aussi fait partie des ressources sur lesquelles doit malheureusement compter un État viable, lui aussi sera détourné de son rôle et utilisé contre la liberté de pensée à l'intérieur des frontières et contre l'autonomie des autres sociétés. L'État, dont l'administration Bush siphonne les ressources, ne fait pas l'objet d'un plus grand respect, mais d'un asservissement plus poussé. N'imaginons pourtant pas que l'administration Bush, brusquement surgie de l'enfer, crée tout à coup le Mal à l'état pur. Worldcom, semble-t-il, tripote ses bilans depuis plusieurs années. Enron fréquentait tous ceux, démocrates ou républicains, qu'attiraient les dividendes pétroliers. L'ex-président Clinton et sa glorieuse épouse ont beau participer aux plus vertueux colloques et y défendre la veuve, l'orphelin et le sidéen, leur règne n'a pas été exempt lui non plus des nominations honteuses et des financements électoraux inavouables. Si différence il y a entre l'administration Bush et ce qui se passait avant ou ailleurs, c'est de septembre 2001 qu'elle découle. Les attentats ont permis à Bush et consorts d'intimider tous les opposants en les menaçant du reproche de déloyauté. Comment pouvait-on critiquer sans avoir l'air de fréquenter ben Laden? Bush en a déduit qu'il pouvait tout faire, y compris caracoler sur le blanc destrier de saint Georges attaquant le dragon; certains lui ont rappelé qu'il s'était fort bien entendu avec le même dragon il n'y a pas longtemps. Bush n'a cependant rien compris. Ses comparses non plus. Je dirais même que plusieurs groupes professionnels sont encore incapables de décoder le message pourtant clair de M. Greenspan. Qu'on lise à cet égard Ralph Nader. Le comptable choisi et payé par une entreprise est, qu'il proteste ou pas de sa vertu, écartelé irrévocablement entre l'intérêt public et son intérêt personnel ou corporatif. On aura beau multiplier les inspections, le système enfantera quand même d'innombrables collusions. Le courtier qui offre avec insistance des actions dont il doit se débarrasser sous peine de crouler sous leur poids fait lui aussi partie d'un système qui, structurellement, multiplie et nourrit les conflits d'intérêts. Pour protéger vraiment l'intérêt public, c'est à ces nombreux conflits d'intérêts structurels qu'il faudrait s'attaquer. On découvrirait alors, aux hurlements des ordres professionnels, que bien des humains, consciemment ou pas, tiennent aux privilèges qu'ils retirent d'un libéralisme économique qui récompense ses fidèles plus qu'il n'assure la protection des investisseurs. Quand le conflit d'intérêt est structurel, la présence de quelques vertueux ne met pas la société à l'abri. L'État protégerait davantage, mais il manque lui-même de soutien et de conviction. |
RÉFÉRENCES :
| |
Imprimer ce texte ACCUEIL | ARCHIVES | ABONNEMENT | COURRIER | RECHERCHE |
© Laurent Laplante et les Éditions Cybérie |