| ACCUEIL | ARCHIVES | ABONNEMENT | COURRIER | RECHERCHE |
|
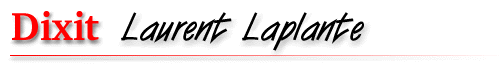 |
|
| ACCUEIL | ARCHIVES | ABONNEMENT | COURRIER | RECHERCHE |
|
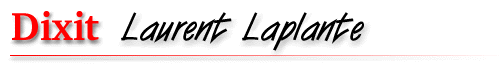 |
|
| Québec, le 1er avril 2002 Jusqu'où un chef doit-il plier? Dans le cadre de ses colloques axés sur de grandes figures politiques québécoises, l'Université du Québec à Montréal (UQAM) a récemment invité des observateurs contemporains à brosser le portrait de l'ancien premier ministre Robert Bourassa. Ses adversaires ont saisi l'occasion de lui reprocher un grave péché d'omission : il n'a pas fait l'indépendance au moment où elle passait à portée de main. De répondre ses fidèles : « Mais pourquoi l'aurait-il faite? Il ne la souhaitait pas ». L'effervescence n'était pas encore calmée que le Parti québécois rendait publique la mise à jour d'une brassée d'études sur la souveraineté et en profitait pour congeler le projet. Le contraste attire l'attention : alors qu'un premier ministre réputé louvoyant se faisait un devoir de résister à la pression populaire, un premier ministre choisi pour la clarté de son discours souverainiste préfère s'abandonner au flot. Plus encore que ses décisions, c'est le style de Robert Bourassa qui a suscité et suscite encore un durable malaise. Quand l'échec de l'accord du lac Meech fit grimper à des sommets inégalés l'humiliation québécoise et l'appui populaire à la souveraineté, Robert Bourassa veilla à ne pas jeter d'huile sur le feu : il fit semblant de partager la colère des citoyens et affirma la pérennité de l'identité québécoise. Déjà, cependant, il travaillait à désamorcer la crise. Il connaissait suffisamment ses compatriotes pour les savoir aussi prompts à l'amnésie qu'à la colère. Rassurés, bien à tort, par les propos faussement belliqueux du premier ministre libéral, les Québécois se calmèrent, s'en remirent à lui et se rendormirent. L'heure de la souveraineté passa. Robert Bourassa, une fois de plus, avait réussi à gagner du temps. Faut-il blâmer un chef politique qui préfère la longévité au geste peut-être aventureux? Que faut-il penser quand un premier ministre empêche délibérément son peuple de céder à ce que lui, berger attentif aux besoins du troupeau, considère comme un mirage? Les réponses à ces questions varient forcément selon les convictions de chacun. Les tenants de la souveraineté vouent une rancune tenace à Robert Bourassa, car le Québec a raté à cause de lui la plus belle occasion qu'il lui ait jamais été donné d'accéder à la souveraineté; ceux qui en tiennent pour le fédéralisme lui rendent grâces, au contraire, de ne pas avoir cédé au parfum capiteux du bouleversement juvénile. Dans les deux camps, une question demeure sans réponse péremptoire : un chef politique doit-il accorder préséance à ses opinions personnelles ou à la volonté populaire? La tentation est forte de répondre prudemment : un chef politique doit savoir écouter et savoir décider. Une question analogue se pose à propos de Bernard Landry, mais inversée. L'homme a accédé au poste de premier ministre en affichant ouvertement ses convictions souverainistes et en se lançant à lui-même le défi de réussir là où un géant comme René Lévesque a échoué. Quand Bernard Landry succéda à Lucien Bouchard, le noyau dur des souverainistes se réjouit, car le nouveau premier ministre ne réserverait pas l'évocation de l'indépendance aux seules occasions officielles. De fait, pendant quelque temps, il fut question de souveraineté. Mais voici que, morosité, attentats et sondages aidant, Bernard Landry, comme son prédécesseur, se concentre sur la gestion de l'État et reconnaît que les Québécois de ce temps n'ont pas l'âme à l'offensive constitutionnelle. Le chef s'incline devant la volonté populaire et met en veilleuse la thèse qui lui est personnellement très chère. D'où l'inversion de la question adressée tout à l'heure à Robert Bourassa : un chef politique est-il à la hauteur de son rôle s'il soumet son programme idéologique aux aléas des humeurs populaires? Là où Robert Bourassa, à force de louvoiements, de propos équivoques et de savants silences, parvenait à naviguer contre le vent, Bernard Landry semble obéir à la brise dominante. Certes, le poids des institutions, qui jouait en faveur de Robert Bourassa, milite contre Bernard Landry. À condition de gagner du temps, Robert Bourassa conservait le fédéralisme en l'état; Bernard Landry, lui, ne peut faire progresser sa cause qu'en obtenant de la population un mandat de transformation radicale des structures politiques. Robert Bourassa affrontait une averse; Bernard Landry aurait besoin d'un changement de climat. Ce n'est pas du même ordre. Notons toutefois que les défis qu'affronte M. Landry ne sont pas tous d'ordre constitutionnel. Ceux qui appartiennent à cette nébuleuse sont pour l'instant hors de portée et M. Landry ne se diminue pas à le reconnaître. Il ne peut cependant pas invoquer les mêmes raisons en ce qui touche à une version moderne de la social-démocratie. Autant le statu quo constitutionnel bénéficie présentement du déséquilibre fiscal qu'entretient le gouvernement central, autant le Parti québécois de M. Landry répondrait à un besoin s'il s'occupait d'occuper en force le centre et le flanc droit de l'échiquier. Autant le vent souffle aujourd'hui de façon irrésistible en faveur de la centralisation profédérale, autant les déséquilibres sociaux favorisent et rendent même urgente une gouverne infiniment plus compatissante et égalitaire. Sur ce front, M. Landry peut et doit résister au déferlement du capitalisme sauvage. Robert Bourassa, chef d'un parti viscéralement voué au libéralisme économique et allergique aux tremblements de terre constitutionnels, manipula cyniquement l'opinion pour maintenir notre régime politique dans ses ornières. Il ne trichait pas, car, à ses yeux comme à ceux d'un Trudeau, le jeu politique ne reconnaît comme règle que l'efficacité et la longévité. Il n'était pas immoral, mais politiquement amoral. Bernard Landry, héritier d'un mouvement politique épris de social-démocratie autant que de souveraineté politique, croit manifester un grand pragmatisme en poussant en touche les deux projets péquistes. Il a raison d'un côté, tort de l'autre. La souveraineté, par les temps qui courent, n'a pas la cote; la social-démocratie, à l'inverse, est vacante et urgente. Ce n'est pas en confondant éducation et contrats de performance ou en gavant General Motors, les alumineries géantes ou Bombardier que le gouvernement de Bernard Landry retrouvera son âme et la faveur populaire. Un chef de gouvernement évite le suicide politique s'il sait mettre en veilleuse ce qui est temporairement inaccessible; il ne se conduit pas en chef s'il se laisse dominer par un courant qu'il peut vaincre. |
| RÉFÉRENCES : Robert Bourassa : un bâtisseur tranquille | |
Imprimer ce texte ACCUEIL | ARCHIVES | ABONNEMENT | COURRIER | RECHERCHE |
| © Laurent Laplante et les Éditions Cybérie |